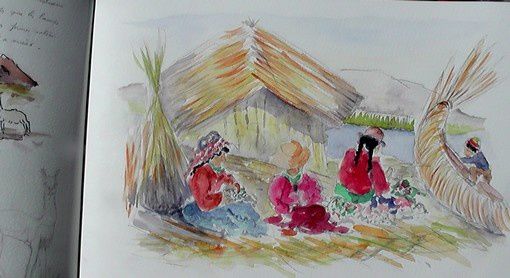Mon père exerçait la profession de pantouflier. Il était le président de la corporation des pantoufliers juifs de Czestochowa. Son autorité était si grande qu'il décrétait la grève d'un seul geste. Il mettait sa machine sur l'épaule et parcourait les rues du quartier. Longtemps, je me suis demandé comment un homme de sa taille qui n'était pas très grande, et de sa robustesse qui n'était pas remarquable, pouvait porter une machine sans se fatiguer.
Dans mes souvenirs, jusqu'à ce que j'apprenne la vérité, mon père était un héros comparable à ceux de l'antiquité. De l'un d'eux, en particulier, qui portait une mappemonde sur l'épaule. Dieu seul sait de quelle corporation, il était le président.
Un jour, j'avais deux ans à peine, il a dit:
- Nous allons quitter la Pologne.
Je me demandais comment des gens pouvaient vivre hors de la Pologne. Personnellement, je n'en connaissais pas. Mais, s'ils y parvenaient, des polonais y parviendraient mieux encore.
A cette époque, en 1929, Paris était déjà une métropole cosmopolite. Les habitants y étaient d'origine russe, polonaise, italienne, espagnole et venaient d'autres pays encore, si bien que lorsqu'ils étaient obligés de s'exprimer en français, ils le faisaient avec un accent à ce point différent l'un de l'autre, que chacun d'entre eux avait le sentiment de parler français mieux que son interlocuteur.
Un cousin de mon père habitait rue Lamarck dans le 18ème arrondissement. Il était fourreur mais moins prestigieux que mon père ne l'avait imaginé. Il est vrai que tant qu'à rêver, autant rêver un peu au dessus de la réalité. Son atelier était son magasin, et les passants pouvaient le voir travailler à travers la vitrine. En été, quand la porte était ouverte, l'odeur de l'atelier, une odeur de cuir mouillé et de suint, empestait la moitié de la rue.
Mon oncle en était tout imprégné lui aussi. Mais il ne s'en rendait pas compte. Homme bien élevé, quand il fumait le cigare, son seul vice, il s'excusait auprès des gens.
- L'odeur du cigare ne vous incommode pas, j'espère.
Mon père prit une chambre, rue Paul Bert, dans un petit hôtel situé dans le même arrondissement, pas très loin d'un cabaret à la façade colorée, illuminé le soir d'ampoules de couleur, qui se nommait le Moulin Rouge. Mais, il n'avait rien d'un moulin malgré ses ailes, du reste immobiles.
C'est dans cet établissement que mon père trouva du travail lorsqu'il décida de rester à Paris quelques temps, le temps de juger si on pouvait y creuser les fondements d'une vie heureuse. La formule était légèrement amphigourique mais elle donnait une touche de noblesse à ce qui, à mon avis, était de l'attirance pour un monde qu'il ignorait, et les couleurs vives revêtues par les parisiennes.
Ce jour là, il rentrait à l'hôtel en passant par le Moulin Rouge lorsqu'un homme qui portait un fauteuil qu'il venait d'extraire d'une carriole faillit le laisser tomber.
- Attention, dit mon père en polonais, je vais vous aider.
- Merci, merci. Dieu merci.
Lui aussi d'instinct s'était exprimé en polonais. Le fauteuil déposé dans le hall, ils éclatèrent de rire tous les deux.
- Ainsi, vous êtes polonais.
- Les polonais sont partout.
- Les polonais, je ne sais pas, mais les juifs, c'est vrai, sont partout. Faut-il s'en étonner? Ils étaient présents à la création du monde. Et peut-être même avant. Je m'appelle Simon Weissberg. En français, c'est Montblanc.
- Moi, c'est Louis Pelzer. Je viens d'arriver de Czestochowa.
- Vous cherchez du travail?
L'affaire fut vite réglée. Monsieur Montblanc cherchait une sorte d'homme à tout faire, et mon père avec sa mine honnête lui inspira confiance. Il commença son travail le soir même.
Monsieur Montblanc n'avait pas de famille. Ni épouse, ni enfants, personne. Des parents, il en avait eu sûrement mais ils étaient morts. Si bien que c'est à mon père qu'il proposa de lui succéder en contrepartie d'une rente raisonnable.
- Louis Pelzer, patron du Moulin Rouge, ça sonne bien.
- Louis Pelzer de Montblanc, ça sonne mieux encore, dit ma mère.
L'affaire fut conclue.
A cette époque, à Paris, la plupart des étrangers, les Russes en tout cas, étaient Princes ou Ducs, le moins élevé en grade était général. Tous, à peu de chose près, étaient taximen le jour, et joueurs de balalaïka, le soir. Seuls les italiens et quelques espagnols n'étaient pas de souche noble ou taximen. Ils étaient peintres dans le quatorzième arrondissement.
Le nouveau nom de mon père : Pelzer de Montblanc n'étonna personne. Son accent polonais pouvait tout aussi bien être russe. Polonais, russe, c'était pareil pour des gens qui ont la réputation d'ignorer la géographie. D’ailleurs, il ne prétendait pas porter de titre de noblesse. Quand il se présentait en disant Pelzer de Montblanc, il voulait signifier Pelzer c'est mon nom, et Montblanc celui de l'homme auquel je succède, mais les gens n'écoutent qu'eux-mêmes et ils n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Ils voulaient entendre Pelzer de Montblanc parce que cela les honorait de parler à un homme dont le patronyme avait une particule. Mon père cessa de les corriger.
Les affaires se développaient grâce aux intuitions de ma mère. Désormais, on dînait au Moulin Rouge et les convives, le vin aidant, parlaient haut tout en regardant les jambes des danseuses. Les filles, c'était l'essentiel, avaient toujours les jambes bien faites et des cuisses pleines et suggestives. Certains soirs, des messieurs attendaient devant la sortie des artistes. C'est dire le succès du New Moulin rouge, et la qualité des spectacles.
Personne ne se rendait compte que l'histoire était en train de basculer. Nous étions en 1936.
Monsieur Blandin, un député, bon client de l'établissement, avait dit à mon père:
- Les allemands viennent d'envahir la Pologne.
- Les allemands? Pourquoi?
- Pourquoi, pourquoi. Mon pauvre ami !
Le spectacle du Moulin Rouge était fort apprécié par la clientèle. C'est ma mère qui choisissait les danseuses, elle connaissait le goût des hommes pour l'anatomie féminine. La formule est un peu vulgaire mais elle correspond à la réalité: Une femme, si elle suggère certaines parties de son corps, que tout le monde connait cependant depuis l'enfance, bouscule le cœur des hommes. La culture, en cette matière, qu'elle soit française, polonaise ou autre, est davantage affaire de sexe que de nationalité.
L'une des danseuses, son nom était Frieda, avait un corps splendide. Il suffisait de l'avoir vue un seul soir se trémousser en costume de scène pour ne jamais plus cesser de ressentir, à vous arracher le bas du ventre, la séduction de son corps. Même lorsqu'elle était habillée, les hommes, immanquablement, l'imaginaient nue.
Personne n'y était insensible. Mon père pas plus que les autres. Et il eut assez rapidement deux femmes, une épouse qu'il respectait, et une maîtresse qu'il respectait tout autant parce qu'il la respectait un peu moins. Ils avaient l'air heureux. Tous les trois.
Personne ne pensait à la guerre qui se déroulait ailleurs. Les journalistes appelèrent cette période la drôle de guerre. Jusqu'à ce que les allemands contournent la ligne Maginot. Et ce fut l'exode.
Le Moulin Rouge resta fermé durant trois semaines. Mon père venait tous les jours se rendre compte de son état. Aucune déprédation ne défigurait sa façade mais le dessin coloré de danseuses levant la jambe, et la reproduction d'un moulin aux ailes figées, alors qu'aucune lumière ne les animait, donnait au tout un air cocasse épouvantablement triste.
- Ce n'est pas possible, monsieur Montblanc, ça ne peut pas continuer comme ça.
Mes parents se morfondaient de l'inaction à laquelle ils étaient acculés. Ils habitaient désormais le haut du Boulevard Caulaincourt dans un immeuble bourgeois.
Par contre, ouvrir le Moulin Rouge alors que les Allemands occupaient Paris, n'était-ce pas manquer de patriotisme, se disait mon père.
- Il faut rouvrir l'établissement, Monsieur Montblanc. Vous avez charge de personnel.
C'est le commissaire du quartier qui le dit à mon père qu'il avait convoqué. Puis, il ajouta à mi-voix:
- Et je ne vous cache pas qu'un officier de la Kommandantur le souhaite également. Un homme charmant. Et très cultivé. Il adore la danse.
Une semaine plus tard, le Moulin Rouge avait ouvert ses portes, une partie de la clientèle était revenue, et des officiers allemands s'étaient attablés devant la scène. Au dehors, toutefois, il n'y avait pour situer l'établissement qu'une lampe bleue qui tremblotait au moindre souffle de vent.
Durant les guerres, la vie des gens tout autant que l'histoire prend des directions que nul ne peut prévoir. Certains d'entre nous s'en rendent compte et changent de vie, d'autres s'efforcent de retrouver la routine habituelle.
Durant la dernière guerre, il faut préciser: celle de 1940, certaines catégories d'êtres humains étaient vouées à la mort. Mais pour les autres, c'était comme si les saisons s'étaient transformées. Elles prenaient une autre couleur à laquelle il fallait s'adapter. Si auparavant les gens étaient tentés de se plaindre de tout et de rien comme si leur vie à chaque fois était en cause, durant les guerres ils deviennent doux comme des moutons.
- Alors monsieur Montblanc, est-ce que ce n'est pas mieux comme ça ?
Le commissaire du quartier était devenu une relation intéressante qui venait visiter régulièrement les coulisses. Il donnait son avis sur les filles. Ou sur les décors. Il avait avoué à mon père que durant son adolescence, il avait rêvé de devenir comédien.
- Eh oui, monsieur Montblanc.
Il disait monsieur Monblanc et non monsieur Pelzer. Mon père, dieu sait pourquoi, était rassuré. Atavisme peut-être il savait que tout finit toujours par arriver, il suffit d'attendre.
Un soir, l'Ober-leutenant Fritz Muller, l'officier charmant et cultivé qui nous avait poussé à rouvrir le Moulin Rouge prit mon père à part.
- Monsieur Montblanc, vous aurez remarqué que de plus en plus de nos soldats fréquentent votre établissement. Les demoiselles y sont remarquables: de vraies parisiennes. Mais il est dommage que les repas ne soient pas à la hauteur du spectacle.
- Que faire? Le rationnement, hélas, à ses limites en matière de gastronomie.
- Allons Monsieur Montblanc, un peu d'imagination.
- Je vous comprends, Herr Major, mais si je me fais prendre ?
- Je vais vous faire établir un ausweis personnel. Après tout, il s'agit du moral de nos troupes.
C'est ainsi que mon père, ouvertement cette fois, alimenta les clients du Moulin Rouge de viande, de beurre, de café, enfin de tout ce qui se mange, se boit ou se fume. Bientôt il eut trop de tout et il approvisionna un de ses amis qui avait ouvert un commerce de gros et occupait une place en vue sur le marché parallèle.
En l'espace d'un an, mon père avait de quoi ouvrir un compte en Suisse et d'acheter des lingots d'or qu'il entreposait dans un coffre à Zurich.
De temps en temps, il offrait à l'Ober-Leutenant une caisse de champagne. S'il dînait au Moulin Rouge, que mon père fut présent ou non, il se voyait refuser de payer l'addition. En véritable gentleman, au bout de quinze jours, pour ne pas mettre le personnel dans l'embarras, il cessa de la demander. Pour ce qui était des danseuses, personne n'était censé intervenir dans des tractations, somme toute, privées.
Frieda resta longtemps la maîtresse de mon père. Il avait de quoi entretenir deux épouses. Elle témoignait de l'ascension sociale de la famille. En outre, ma mère était fière d'être l'épouse d'un homme pourvu de beaucoup de charmes puisqu'il plaisait à d'autres. Ainsi allait la vie. C'est Brecht qui le disait en 1929 déjà, d'abord, il faut bouffer. Après vient la morale.
Jusqu'à la fin de la guerre, mon père, ma mère et Frieda eurent une existence convenable, de celle qu'on peut souhaiter à ses meilleurs amis. Des amis en nombre, une situation professionnelle enrichissante, un statut social enviable.
Sinon que tout cela n'est que le fruit de mon imagination.
C'est vrai que je suis né en Pologne. C'est vrai que mon père était le président des pantoufliers juifs de Czestochowa. C'est vrai que ma mère était belle. Un avenir radieux s'offrait à eux comme à tous les enfants du monde.
Mais j'ignore où ils sont enterrés. D'ailleurs, l'ont-ils été? De la plupart des gens, on connait la date de naissance et celle de leur mort. Je connais les dates de naissance de mon père et de ma mère, j'ai retrouvé sur internet, la date de naissance de nombreux membres de ma famille. Mais d'aucun d'entre eux, je ne connais la date de leur décès. Serait-ce qu'ils sont toujours vivants?
Femme à l'éventail (Après le bal), 1908 (musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg).



 Mais un décor peut en cacher un autre, derrière la façade d'époque de l'hôtel L'Aquila, se cache un décor résolument 20è siècle où défilent même des images de la CNN en continu! La surprise surréaliste – les décors sont de Jean-Guy Lecat – c’est de relier La Gazzetta aux médias actuels qui en prennent pour leur grade avec légèreté et comique délectables. Sur scène une troupe bigarrée d’artistes et des solistes au mieux de leur voix. Chaque costume est une œuvre d’art. Ils sont signés Fernand Ruiz. On hésite entre le carnaval de Venise et les super héros des années 80 ou qui sait, l’imaginaire de Lewis Caroll !
Mais un décor peut en cacher un autre, derrière la façade d'époque de l'hôtel L'Aquila, se cache un décor résolument 20è siècle où défilent même des images de la CNN en continu! La surprise surréaliste – les décors sont de Jean-Guy Lecat – c’est de relier La Gazzetta aux médias actuels qui en prennent pour leur grade avec légèreté et comique délectables. Sur scène une troupe bigarrée d’artistes et des solistes au mieux de leur voix. Chaque costume est une œuvre d’art. Ils sont signés Fernand Ruiz. On hésite entre le carnaval de Venise et les super héros des années 80 ou qui sait, l’imaginaire de Lewis Caroll !