Le conte, et particulièrement le conte merveilleux, est-il, comme le voulait Paul Delarue, «l'expression la plus parfaite de tous nos récits oraux»? Son extraordinaire longévité surprend: le conte égyptien des Deux Frères a été retrouvé sur un papyrus datant du XIIIe siècle avant J.-C., la légende d'Etana et de l'Aigle sur des tablettes exhumées des sables chaldéens. La diffusion du conte dans l'espace n'est pas moins étonnante puisqu'on le rencontre jusqu'au bout de la terre, «là où, dirait le conte, le monde se termine par une palissade de rondins». De ce genre longtemps méprisé, relégué au rang de divertissement pour l'enfant et le peuple ignorants, de ce genre dont on a dit tantôt qu'il «sentait l'eau de Cologne et la poudre d'iris», tantôt la bure et la fumée, tous les spécialistes s'accordent à reconnaître aujourd'hui l'intérêt. Mais n'est-il pas paré de «la beauté du mort» pour nos contemporains en quête de racines?
1. Qu'est-ce qu'un conte populaire?
Si le terme de conte présente, dans la littérature, des acceptions multiples et des frontières indécises, trois critères suffisent à le définir en tant que récit ethnographique: son oralité, la fixité relative de sa forme et le fait qu'il s'agit d'un récit de fiction.
Le conte populaire s'inscrit d'abord dans ce vaste champ qu'en 1881 Paul Sébillot baptise, d'une expression paradoxale, «littérature orale». Comme les comptines et les proverbes, les devinettes et les chansons, il bénéficie de cette «transmission de bouche à oreille» qui caractérise, selon Pierre Saintyves, le «savoir du peuple». Chaque conte est un tissu de mots, de silences, de regards, de mimiques et de gestes dont l'existence même lubrifie la parole, au dire des conteurs africains.
Le conte est, de plus, un récit hérité de la tradition, ce qui ne signifie nullement qu'il se transmette de façon immuable. Le conteur puise dans un répertoire connu depuis longtemps la trame de son récit et lui imprime sa marque propre qui sera fonction de l'heure, du lieu, du public et de son talent spécifique. Le conte populaire est donc à la fois création anonyme, en ce qu'il est issu de la mémoire collective, et création individuelle, celle du «conteur doué», artiste à part entière, qui actualise le récit et, sans en bouleverser le schéma narratif, le fait sien. Le conte participe ainsi, avec la légende, de ce qu'Arnold Van Gennep appelle la «littérature mouvante», par opposition à la «littérature fixée» des proverbes et des dictons qui ne se modifient pas.
À l'intérieur de la littérature mouvante, le conte se singularise surtout par son caractère de fiction avouée. L'incipit «Il était une fois» atteste déjà la rupture avec le monde ordinaire. Les localisations spatio-temporelles du conte merveilleux l'accentuent: «Bien loin, au-delà de l'extrémité du monde et au-delà même des montagnes des sept chiens, il était une fois un roi...» Dans les contes facétieux -comme dans les histoires drôles -,la fiction se marque surtout par le caractère exemplaire de la situation initiale: «Deux Corses se rencontrent sur la place du village.» La légende, au contraire, se donne comme le récit d'événements qui se sont réellement produits et dont les acteurs sont connus; son ancrage historique et géographique l'enracine dans la vie locale. Il faut signaler cependant que l'affirmation de réalité est quelquefois utilisée, en début ou en fin de conte, comme un moyen de capter l'attention de l'auditoire. Le conteur se présente alors comme un intercesseur malicieux entre le monde réel et l'univers imaginaire qu'il vient de faire naître: «On fut bien obligé de lui mettre un nez en bois, c'est mon grand-père le cordonnier qui le lui a fait.»
2. Collecte et classement des contes
Par définition, le conte populaire, transmis de génération en génération, se situe dans ce que Fernand Braudel a appelé la «longue durée». Seules peuvent être datées avec précision les versions manuscrites ou imprimées et les transcriptions de textes oraux que nous ont laissées les ethnographes du siècle dernier.
Comme le souligne Marie-Louise Ténèze, la collecte systématique des contes est postérieure, dans tous les pays d'Europe, à la publication des Kinder- und Hausmärchen des frères Grimm (1812-1815), dont l'impact fut considérable. Elle fut tantôt l'oeuvre d'institutions nationales, comme la Société de littérature finnoise, créée en 1831, tantôt celle d'individualités marquantes qui ont mené et coordonné des enquêtes sur le terrain: Asbjörnsen en Norvège, Svendt Grundtvig au Danemark, Pitré en Sicile, Paul Sébillot puis Arnold Van Gennep en France... En moins d'un siècle, ces collectes permirent d'accumuler un matériau immense, dont le classement même faisait problème: plus de trente mille documents pour les seules archives d'Helsinki en 1918. En dépit de la bigarrure des textes recueillis, les ressemblances sensibles entre les contes, d'une province à l'autre et d'un pays à l'autre, permirent au Finnois Antti Aarne de définir, dès 1910, la notion de conte type: une organisation de motifs suffisamment stable pour s'être inscrite dans des récits divers, un schéma narratif privilégié avec insistance par les conteurs, une «ornière traditionnelle», selon l'expression d'Ariane de Felice -si l'on admet que la narration emprunte fréquemment cette «ornière» sans s'y enliser jamais.
Le recensement des contes types, initialement mené à partir des collections scandinaves et germaniques, s'élargit bientôt à l'ensemble de l'Europe puis à l'Inde. Il aboutit à l'établissement d'une classification internationale à laquelle sont indissolublement liés les noms d'Antti Aarne et de Stith Thompson, auquel on doit aussi le monumental Motif-Index of Folk-Literature. La classification Aarne-Thompson comprend aujourd'hui 2340types répartis en quatre catégories: les contes d'animaux (T. 1 X 299), les contes proprement dits, qui incluent les contes merveilleux et les contes religieux (T. 300 X 1199), les contes facétieux (T. 1200 X 1999) et les contes à formule, qui sont souvent des randonnées ou contes en chaîne (T. 2000 X 2340). L'Aarne-Thompson a rendu possibles les monographies de contes par la comparaison de toutes les variantes et l'établissement de catalogues nationaux. Celui de Paul Delarue et de Marie-Louise Ténèze pour le conte populaire français est, à cet égard, exemplaire. Pour chaque conte type nous est donné le texte d'une version de référence puis un découpage narratif, suivi de la liste de toutes les versions recensées avec l'inventaire de leurs motifs. Chaque conte est assorti d'un commentaire. Lorsque les versions issues d'une aire géographique donnée présentent des caractères originaux, et ce, de façon persistante, on parle d'«ocotypes régionaux», reprenant en cela un terme proposé par Carl Wilhelm von Sydow.
Il est assez frappant de constater que l'ardeur des collecteurs du XIXe siècle concernant le rassemblement des textes oraux semble s'accompagner d'une relative indifférence aux circuits de transmission du conte. Ils nous ont laissé peu d'informations sur la personnalité des conteurs, sur leur pratique narrative et sur les institutions de transfert qui ont permis aux contes de se perpétuer. Les ethnologues d'aujourd'hui attachent, au contraire, la plus grande importance à l'«horizon d'attente» dans lequel le conte surgit: «Par tout un jeu d'annonces, de signaux -manifestes ou latents -,de références implicites, de caractéristiques déjà familières, écrit Hans Robert Jauss, le public est prédisposé à un certain mode de réception.»
3. L'horizon d'une attente
Le conte traditionnel est inséparable de la communauté dans laquelle il s'inscrit: «Ce qui est premier, écrit Max Lüthi, c'est le besoin intérieur du conte que ressentent ceux qui le créent, ceux qui le cultivent et ceux qui l'entendent.» À cette notion un peu vague de «besoin intérieur», on préférera celle de «fonction textuelle» (rôle joué par le texte dans le système social) et la typologie des fonctions que proposent Daniel Fabre et Jacques Lacroix.
Le texte oral ne peut, en effet, se définir que dans un réseau de fonctions dont l'importance varie selon le récit, le public et l'époque considérés. Les témoignages contemporains privilégient surtout la dimension ludique du conte. Dans les sociétés traditionnelles, l'activité narrative est une forme privilégiée du loisir, encore qu'elle s'accompagne souvent d'un travail accompli pendant le temps du contage (dentelle, tricot, vannerie, écalage des noix, etc.). Parmi les diverses sortes de jeux que combine l'activité narrative, la compétition paraît être surtout sensible dans les veillées où il n'y a pas de grand conteur. L'imitation prévaut dans les mimologismes, ces brefs récits qui suggèrent une interprétation amusante des chants d'oiseaux et des cris d'animaux, tel ce dialogue autour d'un fermier endetté: «La caille chante: Paye tes dettes! Paye tes dettes! La perdrix: Payera-t-i? Payera-t-i? La pintade: Peut-être. Peut-être. L'oie: J'paierons, j'paierons. Les canards: Quand, quand, quand, quand. Le mouton: Jamais.»
On conte donc, c'est vrai, pour jouer, pour rire ensemble. Mais si cette fonction ludique existe, tout particulièrement dans les mimologismes et les contes facétieux, elle n'avait probablement pas, dans la hiérarchie culturelle traditionnelle, l'importance que nous lui accordons aujourd'hui: nous plaçons commodément sous le signe du divertissement des textes dont le sens et les résonances nous échappent. Une autre réduction fréquemment opérée, cette fois pour les contes merveilleux, consiste à exalter leur dimension esthétique, ce qui marque bien notre distance par rapport à ces «belles histoires» issues d'un «vieux vieux temps». Comme le soulignent Daniel Fabre et Jacques Lacroix, «le texte, devenu le plus étranger par son contenu, suscite une adhésion esthétique de substitution».
Or le conte traditionnel ne se définit pas seulement par le plaisir du jeu ou le désir du Beau. Il est aussi l'expression d'une mémoire anonyme et collective qui joue sur différentes modalités du temps: le temps mythique, celui des origines, radicalement coupé du nôtre («C'était au temps où les bêtes parlaient»), le passé indéfini du conte merveilleux («Il était une fois»), le temps historique, mais d'une histoire intermittente qui laisse dans l'ombre des siècles entiers pour isoler des faits saillants (en Auvergne, le passage de Mandrin par exemple), le temps familial qui inscrit le récit dans une généalogie parfois fictive («Le grand-père de mon grand-père de mon grand-père...»), le temps personnel, enfin, évocation mélancolique de la jeunesse du récitant («De mon temps, les filles étaient sages, les arbres portaient plus de fruits», etc.). Quelles que soient les modalités choisies, le temps du conte a ses lois propres: le héros construit un palais en une nuit, la princesse dort pendant cent ans.
Le récit oral remplit aussi une fonction d'information. Celle-ci est bien sûr appauvrie, amplifiée, déformée d'un relais à l'autre puisqu'elle est soumise aux errances de la mémoire et aux mouvances de la parole. La narration se donne alors comme vraie, bien qu'on ne puisse jamais remonter à la source de l'information. Dans un univers familier, balisé, le conteur choisit l'instant privilégié où le cours ordinaire des choses de la vie se trouve tout à coup rompu: le conteur, selon Per Jakez Helias, c'est «quelqu'un qui est frappé d'inspiration là où les autres ne voient qu'incidents». Les rumeurs, comme les récits de sorcellerie qui en sont le produit, ne décrivent rien d'autre que cette «irruption de l'inadmissible» qui caractérise, selon Roger Caillois, le récit fantastique. Au conte traditionnel de la chasse volante, où un homme qui a tiré sur des esprits nocturnes voit tomber devant lui une jambe sanglante, fait écho aujourd'hui la rumeur de l'automobiliste qui, arrêté par des loubards, s'échappe en voiture mais trouve sur le capot une main arrachée. Les auto-stoppeurs, les loubards -comme jadis les brigands et les voleurs de grands chemins - sont les incarnations d'une marginalité jugée menaçante. Ils reflètent les peurs d'une époque.
Les normes sociales en vigueur affleurent donc très nettement dans ces récits, ce qui permet d'appréhender la dimension morale du conte. Dans les contes christianisés, le monde s'ordonne autour de deux pôles antagonistes -le Bien et le Mal, le Diable et le Bon Dieu -dont le conflit anime la création. Si les légendes et les vies de saints exaltent des actions que le groupe juge exemplaires, dans les contes facétieux, en revanche, on rit d'un comportement jugé inacceptable qu'on attribue généralement aux membres d'une communauté linguistiquement et géographiquement proche pour mieux marquer sa supériorité. Ainsi, en France, les histoires corses raillent-elles la paresse, les histoires juives l'avarice, les histoires belges (dont on sait la récente fortune) la sottise, etc. Les Wallons, à leur tour, se moquent des Flamands, et réciproquement. Par là se trouvent renforcés les liens de connivence du groupe. Certains contes témoignent d'une satire sociale, telle cette description de l'enfer: «Y avait quelques ouvriers, pas beaucoup, mais y en avait. Des paysans aussi, quelques-uns, mais y en avait. Des bourgeois, y en avait des tas: des avocats, des sénateurs, des députés, des ministres, c'était bourré!» (Félix Bouche, maçon, de Chassagnoles, 9 décembre 1978).
À ces fonctions définies par Daniel Fabre et Jacques Lacroix, il convient d'ajouter la fonction étiologique, présente dans cette catégorie de récits que les folkloristes ont appelés les «pourquoi»: pourquoi les chiens et les chats se disputent (conte type 200), pourquoi les ours n'ont pas de queue (conte type 2), pourquoi les colombes ne pondent que deux oeufs (conte type 240)... Morten Nojgaard, cité par Marie-Louise Ténèze, définit l'étiologie par le fait qu'elle juxtapose deux sections temporelles: son but est «d'exposer une certaine chaîne d'actions dans un passé éloigné, et, ensuite, d'en tirer la conséquence qui explique un phénomène donné de la réalité du lecteur». Ainsi, dans le conte type 295, célèbre par la version des frères Grimm, c'est une promenade ancienne de la braise, de la paille et du haricot qui explique une particularité botanique présentement observable: le fait que tous les haricots du monde ont une couture noire sur le dos. À ce récit, Claude Lévi-Strauss attribuerait sans doute un rôle «démarcatif»: «il n'explique pas vraiment une origine, et il ne désigne pas une cause; mais il invoque une origine ou une cause (en elles-mêmes insignifiantes) pour monter en épingle quelque détail ou pour «marquer une espèce». Marie-Louise Ténèze distingue en outre les contes intrinsèquement étiologiques, construits en fonction de l'explication à fournir, des contes à fin étiologique extrinsèque où l'on surajoute une conclusion étiologique (la petite couture noire) à un récit qui se suffit parfaitement à lui-même.
La fonction initiatique des contes a déjà fait couler beaucoup d'encre. Si l'on définit l'initiation, d'un point de vue sociologique, comme un processus acculturatif qui prépare à la vie adulte en interdisant tout retour en arrière, le conte paraît lui être étroitement lié. Non pas tant, comme le voulait Pierre Saintyves, parce que les contes subsisteraient comme les ultimes souvenirs de rites tombés en désuétude que parce qu'ils utilisent un langage symbolique du devenir, de la métamorphose. On sait, par les recherches de Geneviève Calame-Griaule, à quel point les Dogon associent le conte à la sexualité. Ils y voient une «parole de nuit», une parole de désir, indispensable aux mariages comme aux naissances et dotée elle-même d'un tel pouvoir fécondant que l'échange de contes est interdit entre les catégories de parenté soumises au tabou de l'inceste (père et fille, mère et fils, frère et soeur). Plus près de nous, Yvonne Verdier interprète le Petit Chaperon rouge de la tradition orale comme un récit lié à l'initiation des filles. Après avoir brisé son habit ou ses sabots de fer, l'héroïne part à la rencontre du loup-sphinx qui, à la croisée des chemins, l'invite à choisir entre «le côté des aiguilles» et «le côté des épingles» (la sexualité libre et le mariage). Parvenue chez la grand-mère, elle acquiert, lors d'un macabre festin, le pouvoir de procréer en mangeant les mamelles et en buvant le sang de son aïeule. Elle sera enfin initiée sexuellement lorsqu'elle verra le loup dans son «déshabillé». Le conte utilise du reste tout un lexique lié au travail du fil: l'aiguille et l'épingle, le chaperon et la dent de loup, la chevillette et la bobinette. En jouant sur les termes techniques d'un code artisanal (la couture ou la dentelle), qui relève d'un savoir-faire féminin, le conte populaire retrace une aventure où se lit le destin des femmes.
Parions que le lecteur, s'il n'est pas ethnologue, n'aura guère reconnu Le Petit Chaperon rouge qui fait pourtant partie de notre patrimoine. C'est que la tradition orale a été, par l'intervention de Perrault, des frères Grimm, puis des éditions pour la jeunesse, censurée, mutilée et, sur certains points, pervertie. Certaines de ces transformations (l'adjonction d'un dénouement optimiste dans la version de Grimm par exemple) ont peut-être été dictées par le souci d'adapter le conte au destinataire enfantin.
4. L'enfant et le conte
Le frontispice de l'édition originale des Contes du temps passé de Perrault (1697) représente une paysanne filant au coin du feu et faisant de beaux contes aux enfants qui l'entourent. Contes de vieilles, contes de servantes ou de nourrices, disait-on pour désigner ce que Cicéron appelait déjà des fabulae aniles. Ce stéréotype très ancien a permis de confondre dans le même mépris la tradition orale avec l'univers domestique, celui des femmes et des petits enfants. Or, dans les sociétés traditionnelles, les contes étaient destinés aux adultes. C'est seulement à partir du XVIIe siècle en France que le répertoire de la littérature orale et celui de la littérature de jeunesse ont été confondus.
L'amalgame a sans doute été favorisé par le fait que les enfants, admis aux veillées paysannes qui rassemblaient la communauté tout entière, y ont pris du plaisir et se sont appropriés peu à peu ces histoires pour grandes personnes. Ce goût de l'enfant pour le conte -et particulièrement pour le conte merveilleux -a été diversement expliqué.
La première hypothèse avancée par les psychologues, c'est que les contes fournissent à l'enfant un univers aisément déchiffrable parce que fondé sur des oppositions très marquées entre petits et grands, riches et pauvres, bons et méchants. Ce dernier clivage ne correspond pas toujours à une antithèse d'ordre éthique, puisque les valeurs positives se trouvent par définition du côté du héros. Or les recherches de Piaget et de Wallon ont montré que l'enfant est incapable de concevoir des séries graduées d'objets: le monde s'ordonne pour lui autour de couples contrastés qui ne comportent pas d'intermédiaire. Les contes merveilleux ne fonctionnent pas autrement.
Par ailleurs, le schéma narratif de ces contes fournit à l'enfant ce qu'Éric Berne appelle un «scénario de gagneur». Au début du récit, le héros est défavorisé par sa taille (le Petit Poucet, la Moitié-de-Coq), son apparence physique (Riquet à la houppe), son intelligence (c'est un «songe-creux», un idiot de village), sa condition sociale (il n'a pas un sou vaillant) et surtout par son âge (il est presque toujours le cadet de la famille). Il va cependant affronter toutes les épreuves, et il viendra à bout de plus puissant que lui. Message optimiste pour l'enfant, qui retrouve dans les handicaps du héros une image de sa situation dans l'univers des adultes. La moralité du Petit Poucet de Perrault n'exalte-t-elle pas la victoire du «petit marmot», d'abord méprisé, méconnu, et qui pourtant triomphe de l'Ogre?
Pour Bruno Bettelheim, le conte a surtout le mérite d'exprimer des réalités que l'enfant pressent mais dont il ne veut pas -ou ne peut pas -parler. Ainsi les plus célèbres de nos contes merveilleux évoquent à mots couverts le tabou de l'inceste (Peau d'Âne fuit son père qui voudrait l'épouser), la crainte de la castration (le loup de Prokofiev a la queue coupée), la scatologie (dans les versions orales anciennes, le loup des Trois Petits Cochons détruit les maisons non par le souffle, mais par la seule force de son pet destructeur). La sexualité est donc présente dans les contes, mais sous une forme symbolique qui sollicite l'inconscient de l'enfant. «-Où faut-il mettre mon tablier?», demande le Petit Chaperon rouge de la version nivernaise. «-Jette-le au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin», dit le loup. Pour chaque pièce du vêtement, le dialogue se répète, sans que jamais la fillette s'étonne de l'étrange réponse qui lui est faite. Elle effectue docilement son strip-tease, elle sait et ne sait pas, elle veut et ne veut pas ce qui va arriver. Il en est de même pour l'enfant pour qui tout le plaisir du conte gît dans cette attente angoissée et délicieuse du moment où le loup et la petite fille seront enfin ensemble dans le lit.
Dans la version de Perrault, l'histoire, on le sait, finit mal puisque l'héroïne périt dans la gueule du loup. Dénouement sombre, conforme au schéma narratif des contes d'avertissement: une interdiction est formulée, que le héros transgresse, appelant ainsi sur lui le châtiment. Paradoxalement, ces contes cruels sont les seuls de notre tradition orale qui aient été conçus pour les enfants, afin de les prévenir de tous les dangers qui les menacent. Dans le cas du Petit Chaperon rouge, le contenu de l'avertissement a varié. La moralité de Perrault met en garde les jeunes filles contre les loups «doucereux» qui les accostent alors que, dans les éditions enfantines d'aujourd'hui, le dénouement sanctionne la désobéissance. L'illustration reflète bien cette évolution: l'héroïne au XVIIIe siècle a les charmes d'une adolescente, de nos jours elle a trois ou quatre ans à peine. Dans sa célèbre psychanalyse de l'Homme aux loups, Freud a dénoncé les dangers de ces contes d'avertissement qui peuvent frapper durablement des êtres sensibles, puisqu'ils participent d'une «pédagogie de la peur». Faut-il vraiment, comme le veut une tradition auvergnate, dire à un enfant qui ne se mouche pas que son nez va pourrir, à une petite coquette qui se regarde trop souvent dans la glace qu'un jour elle y verra le diable, à un enfant qui refuse de se laver les cheveux que les poux feront une corde de cette chevelure et le traîneront à la rivière? Ces divers monstres risquent fort de resurgir dans ses cauchemars.
Reste que, sous ses autres formes, le conte représente un matériau psycho-pédagogique irremplaçable. C'est un «abécédaire, où l'enfant apprend à lire dans le langage des images», souligne Bruno Bettelheim. C'est aussi un réservoir fantasmatique qui lui permet, par les scénarios réconfortants qu'il offre, de se libérer de ses craintes. Il donne de plus à la mère (à l'adulte) la possibilité d'établir une relation chaleureuse et un dialogue véritable avec l'enfant. Sara Cone Bryant a montré, dans un ouvrage déjà ancien, à quel point le conte était fait pour être dit, non pour être lu. C'est à cette condition seulement qu'il remplira pleinement sa fonction, qu'il favorisera l'adaptation de l'enfant au monde qui l'entoure et sa découverte des autres.
5. Transcription ou trahison?
Parole vivante, le conte est inséparable d'un corps. Les intonations du récitant, le timbre de sa voix, ses silences et ses pauses, les accélérations brusques et les lenteurs calculées de la narration, les gestes qui prolongent le message, le dramatisent ou le nuancent, voilà ce qui fait le charme du conte, un charme si fort qu'il crée autour du récitant un véritable cercle magique. Dans la montagne tibétaine, rappelle Jeanne Demers, «les auditeurs, assis autour d'une aire préalablement saupoudrée de farine d'orge grillée, finissent par apercevoir sur celle-ci -on le prétend du moins! -les traces des sabots des chevaux dont il est question». Mais les «traces des sabots» ne risquent-elles pas de demeurer à tout jamais cachées à celui qui ne connaîtra du conte qu'un texte écrit?
Les ethnologues, au nom d'une fidélité exigeante à la matière populaire, affirment la nécessité d'une transcription littérale. Ils veulent des récits authentiques, datés, localisés avec précision, matériau précieux parce que sans retouche qui, seul, aura valeur de document. Le collecteur doit être un simple sténographe et faire sienne la règle d'Arnold Van Gennep: «tout noter intégralement, sans faire intervenir une critique littéraire, affective ou morale, ni évaluer ce qui est populaire au moyen de mètres artificiellement construits». On peut se demander cependant si l'oralité ainsi recueillie n'est pas toujours résiduelle. Car l'utilisation des moyens techniques dont on dispose pour enregistrer le conte (magnétophone, magnétoscope) et la simple présence d'un observateur extérieur modifient les conditions de transmission du texte oral et, par là, le texte lui-même. Par ailleurs, les indications ethnographiques échoueront toujours à restituer l'art du conteur. «La conteuse marmotte d'un air mécontent quelques mots impossibles à saisir.» Qui reconnaîtra dans cette notation le bêlement d'une chèvre maussade?
Face aux hommes de science, un certain nombre d'écrivains ont revendiqué, en termes plus ou moins véhéments, le droit de faire leur cette matière populaire qui a inspiré nos plus grands artistes. Les contes de Perrault apparaissent à l'analyse comme une reconstitution savante dont Marc Soriano a montré qu'elle «associe subtilement les croyances du temps jadis et une ironie qui, pour ainsi dire, les désamorce de l'intérieur». Si les frères Grimm se font un devoir de restituer fidèlement le contenu des contes recueillis, ils admettent bien volontiers que, dans le domaine stylistique, «l'expression et l'exécution du détail viennent d'eux pour la plus grande part». Andersen mêle librement dans ses recueils des récits d'origine folklorique (La Colline aux Elfes, Le Petit Elfe Ferme-l'oeil) à des textes purement littéraires. Au XXe siècle, Henri Pourrat, dont le Trésor rassemble près d'un millier de contes, s'affirme comme un défenseur passionné de l'adaptation lorsqu'il reproche aux folkloristes d'avoir fait oeuvre de mort: «Le folklore représente le peuple comme un fagotier représente un arbre. Le peuple en vie ne se trouve pas dans les recueils.» N'est-il pas vain de vouloir localiser les contes, alors que ceux-ci, par nature, manquent toujours d'état-civil? Par ailleurs, n'est-il pas légitime de restaurer une version mutilée, appauvrie en la complétant par d'autres qui ne sont pas moins populaires? Pourrat réclame en somme pour lui-même la liberté souveraine du conteur et le statut de ce «pourra», de ce pauvre qui va dans le Forez de ferme en ferme, «colportant les nouvelles, contant les contes, chantant les chansons».
Si le conte est par nature cette «fiction intentionnelle» dont parle Vladimir Propp, est-il susceptible de s'intégrer dans des structures narratives plus vastes? Les folkloristes ont depuis longtemps souligné la tendance des contes à s'agglutiner entre eux et taxent de «contamination» ces mariages qui mettent en péril la belle ordonnance de la classification Aarne-Thompson. À ce terme connoté négativement, on préférera celui d'«affinité» que propose l'école hongroise: l'attraction spontanée entre des formes existantes fait surgir des formes nouvelles. En littérature, les recueils ont longtemps privilégié le récit cadre qui permettait de mettre en place une société conteuse où divers personnages exercent tout à tour la fonction enviée de narrateur (Le Décaméron, L'Heptaméron). Dans Les Mille et Une Nuits, cette structure en abyme se reproduit à l'infini comme dans les poupées gigognes. Tzvetan Todorov a mis en évidence ce procédé d'enchâssement: «Chahrazade raconte que Dja'far raconte que le tailleur raconte que le barbier raconte que son frère (et il en a six)...» (La Malle sanglante, Khawam, I). La vie de Chahrazade est suspendue au fil d'une parole chaque nuit renouvelée, puisque «raconter égale vivre».
Un autre type d'enchâssement est utilisé par Henri Pourrat dans son roman Gaspard des Montagnes. Du conte type 956B, répandu dans toute l'Europe et en Inde, Pourrat avait recueilli plusieurs versions dès avant 1914: c'est l'histoire de la main coupée qui détermine le destin d'Anne-Marie Grange et la trame principale du roman. Mais ce récit encadre lui-même des épisodes secondaires, issus de la tradition orale. De sorte que Gaspard des Montagnes se présente comme un immense tissu de contes où la société paysanne imprime et donne à voir sa propre image. En revanche, le personnage central de Gaspard qui assure l'unité de l'oeuvre est une création de Pourrat, car le conte, à la différence du roman, ne comporte que des personnages sans épaisseur.
6. Le conte, mort ou vif?
Le conte, on l'a vu, naît toujours de la rencontre de deux imaginaires. Si la mémoire collective, au terme d'une lente décantation, en fixe le schéma narratif, celui-ci ne prend vie que lorsqu'il s'incarne dans un artiste à part entière, conteur doué ou écrivain. Mais cette existence même semble menacée, et nombre d'observateurs annoncent que le conte, en Europe occidentale tout au moins, est voué à une disparition prochaine. Aussi le discours sur le conte se conjugue-t-il aujourd'hui à l'imparfait: «Il était une fois les contes...» Ce «Il était une fois» ouvre la porte à bien des nostalgies. Le conte merveilleux éveille au coeur de chaque citadin le rêve d'un ailleurs et d'un jadis sur lequel la pauvreté, la laideur et la sauvagerie n'avaient aucune prise. Les contes ont pris le chiffre de cette campagne idyllique où ne sévissaient ni la pollution, ni les engrais, ni les tracteurs, ni les usines, où le soleil poudroyait, où l'herbe verdoyait sans le secours des écologistes. Mais soeur Anne sur sa tour ne voit plus rien venir. Car le conte est fini pour nous.
Or, il en est du conte comme de tout objet folklorique: «on le voit surtout lorsqu'il semble disparaître», écrit Nicole Belmont; au XIXe siècle déjà, Gérard de Nerval évoque ces «histoires qui se perdent avec la mémoire et la vie des bonnes gens du passé». Mais, comme le note Michael Screech, le Chicanou de Rabelais ne s'exprime pas autrement: «Toutes bonnes coutumes se perdent», affirme-t-il dès 1541.
Si donc le conte merveilleux, lié à la société rurale traditionnelle, s'estompe dans les mémoires défaillantes des conteurs paysans, gardons-nous de conclure un peu hâtivement à la mort du conte et du texte oral en général. Le déclin des veillées à la campagne ne doit pas nous faire oublier les autres institutions de transfert où la parole circulait et circule encore: le café, le foirail, la rue, le pas-de-porte, le magasin ou le bureau de poste aujourd'hui. Dans les cours de récréation, le folklore enfantin intègre les personnages de la télévision (les Dalton ou Goldorak), de la publicité (les enzymes gloutons); il n'en reste pas moins plein de «comptines coquines», plein de zizis coupés et de «cacas-boudins» qui échappent au contrôle des parents et du maître. Les clochards, oubliés sur leurs bancs par notre société de consommation, se racontent inlassablement des histoires de clochards. Dans les prisons retentissent toujours ces chansons de taulards qui ont inspiré à Pierre Goldman quelques-unes de ses plus belles pages. Partout où il y a privation d'espoir le récit oral existe, car il est un moyen de résistance active. À Per Jakez Helias qui demandait à un conteur breton: «Pourquoi contez-vous?», ce dernier répondit: «Si je conte c'est pour réagir contre tout ce qui nous brime.»
Les littératures


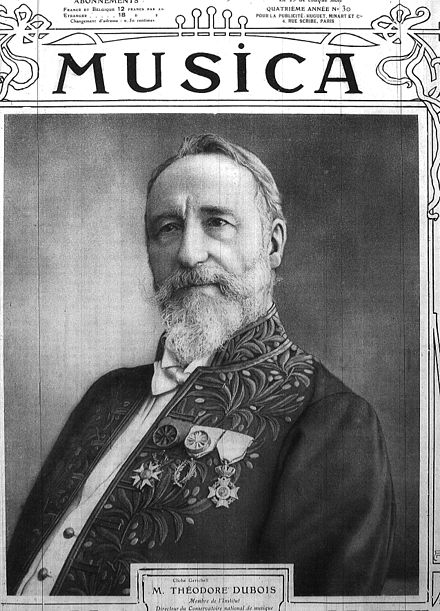 Orchestre Royal de Chambre de Wallonie,
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie,






 Du jeudi 25 février au samedi 26 mars 2016 au théâtre du Parc
Du jeudi 25 février au samedi 26 mars 2016 au théâtre du Parc