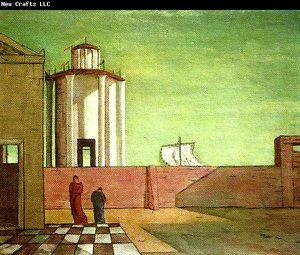Cet article a été écrit au moment de la mise en place du socle commun et de l'évaluation par compétences en France, sous le ministère de Luc Chatel et le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Il ne mentionne pas un fait très important qui explique pourquoi vous avez la même réforme en Belgique que nous, ici, en France : cette réforme correspond aux "critères de convergence" du Traité de Lisbonne et de la commission européenne concernant l’Éducation.
" - A quelle sauce voulez-vous être mangés ?
- Mais nous ne voulons pas être mangés !
- Là n'est pas la question."
Ce "savoureux" dialogue extrait d'une comédie de Courteline pourrait illustrer à merveille les multiples journées ou demi-journées pédagogiques auxquelles les enseignants de collège sont régulièrement conviés. .
On pourrait croire qu'il s'agit-là de "consultations démocratiques" où les acteurs de terrain sont appelés à apporter leur pièce à un édifice en construction. Il n'en est rien ; comme toujours dans l’Éducation nationale, les consultations sont lancées quand les jeux sont déjà faits.
Il en est ainsi de la nouvelle lubie de la rue de Grenelle : "l'évaluation du socle commun des connaissances et des compétences".
Bien que prenant ma retraite à la fin de l'année, je m'étais suis rendu, moi aussi à la grand messe (je veux dire à la réunion "plénière"), après ma journée la plus chargée sur deux établissements, dont un en ZEP, réunion plénière suivie d'une réunion par discipline, au cours de laquelle je m'étais aperçu que l'on nous demandait de copier dans un "document maison" un document national émanant du rectorat, autrement dit, qu'il ne s'agissait nullement d'apporter notre pierre à l'édifice et encore moins de porter un regard critique, mais de montrer notre zèle à s'approprier la vérité révélée.
Beaucoup de collègues sont sans doute dans mon cas, partagés entre le scepticisme et le soupçon et aimeraient bien entendre un autre son de cloche que celle de la "Bonne Parole" officielle.
Je les invite donc à lire les analyses que font de la notion de "compétence" Nico Hirtt, enseignant syndicaliste, agrégé de sciences physiques, enseignant dans le Brabant Wallon, membre fondateur de l'APED (Appel pour une Ecole Démocratique), rédacteur en chef de la revue trimestrielle "L'Ecole démocratique" et auteur de divers ouvrages sur l'école : "sous le couvert d'un discours parfois généreux et moderniste autour de l'obsession des compétences pourrait bien se cacher une opération de mise au pas de l'enseignement : sa soumission aux besoins d'une économie capitaliste en crise."
Point de vue complété par Angélique del Rey, professeur de philosophie, auteur d'un ouvrage intitulé "A l'Ecole des compétences" dans lequel elle expose sa réflexion sur la notion pratique de l'évaluation des compétences dans un certain nombre de systèmes éducatifs, dont le nôtre. Que signifie cette "révolution copernicienne" qui consiste à remplacer le savoir par les compétences. Quelles en sont les conséquences, quels en sont les risques, quels en sont les enjeux réels ?
Pour Angélique del Rey, la notion de compétences "est au croisement de trois processus, dont aucun n'est éducatif en son essence : processus de mesures et d'évaluation des aptitudes (issu notamment de la recherche en psychologie cognitive), processus économico-politique (modélisation de l'éducation comme marchandise), processus de gestion des ressources humaines qui a contaminé l'école dans les années 80, via la formation professionnelle et l'orientation scolaire."
Extrait d'une discussion entre Daniel Arnaud et Guy Morel sur le blog "Bonnet d'âne" "Bonnet d'âne" de Jean-Paul Brighelli :
Le socle commun est acceptable à condition toutefois de mettre en quarantaine la notion de "compétence" et de distinguer nettement entre le "socle commun" des connaissances et l'évaluation proprement dite, inacceptable en l'état.
Après tout le socle commun réintroduit ces indispensables "connaissances" passablement passées à la trappe depuis la Loi d'Orientation de 89. (Daniel Arnaud)
Le socle commun et l'évaluation forment un tout dont la véritable finalité n'est pas le socle, mais l'évaluation. (Guy Morel)
La mise en place du socle commun des compétences et des connaissances signifierait donc l'appauvrissement à terme de programmes déjà bien mis à mal, le suppression de la notation, la transformation des établissements scolaires en "lieux de vie" et "de socialisation", la disparition des enseignements disciplinaires et de la rigueur des apprentissages, au profit d'un vague vernis, d'une "culture de salon" inspirée de celle des médias les moins exigeants.
Il convient d'ailleurs de remarquer l'entente qui règne actuellement entre le ministre de l’Éducation nationale (Droite libérale) et certaines organisations de Gauche, de parents (FCPE), d'enseignants et de lycéens (on l'a vu encore dernièrement avec la Réforme deuxième mouture des lycées, dite Réforme Chatel), qui est en réalité une série de propositions de certains syndicats d'enseignants de Gauche (le SGEN-CFDT et le SE-UNSA, mais pas le SNES), reprises avec une grande habileté tactique par le Droite.
Le SNALC s'est prononcé contre et le SNES semble avoir enfin compris que la défense des enseignants (et de l'enseignement) était incompatible avec le pédagogisme et la démagogie "new age".
Plus inquiétante est la subtile entreprise de formatage idéologique des élèves et de l'école, sous couvert de "développement de la créativité" et "d'implication dans la vie sociale".
La finalité ultime du "socle commun" et de l'évaluation des compétences est en réalité de supprimer la notion et la réalité même des savoirs et de retirer aux professeurs leurs fonctions d'évaluation pour la transférer aux chefs d'établissement, qui peuvent, à leur gré, valider des "items" refusés (un item est un mot savant pour désigner la déclinaison d'une compétence générale en l'une de ses composantes particulières (ex. : "compétence 1 : la maîtrise de la langue française, "item 1" : lire/ lire à haute voix, de façon expressive un texte en prose ou en vers), comme ils peuvent déjà, depuis la Loi d'Orientation de 89, prononcer le passage en classe supérieure en dépit des recommandations du conseil de classe.
Ce nouveau "gadget pédagogique" rejoint donc les différents "bidouillages" destinés à faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes : note de vie scolaire qui descend rarement au-dessous de 15, quel que soit le comportement de l'élève et qui permet de "remonter" artificiellement la moyenne, baisse drastique des exigences des examens ; en aval : confection des sujets et en amont commissions d'harmonisation ... "harmonisation" : "Ah ! qu'en termes galants ces choses-là sont dites !" Valorisons, valorisons, il en sortira bien quelque chose !
(NB : "harmoniser" dans la novlangue Educnat. signifie ajouter des points aux copies des candidats à un examen (brevet, bac.) indépendamment de la valeur objective desdites copies, de manière à ce que les résultats correspondent au taux de réussite attendu.)
Ce n'est pas l'approche par compétences et la mise en place d'un "socle commun" qui diminuera la "reproduction" sociale et régulera la sélection par l'argent, les relations, le lieu d'habitation et les "habitus" de classe pour parler comme Pierre Bourdieu, pas plus que la mise en place de la "discrimination positive" au mépris de la tradition républicaine de l'anonymat des concours que veulent mettre en place Richard Descoins et Alain Minc à l'entrée des Grandes Écoles (c'est fait)
Le système scolaire français, l'école primaire "lieu de vie" où l'élève "construit son propre savoir" et se contente "d'observer la langue", ainsi que le collège unique prétendument "démocratique", contribue au renforcement des inégalités sociales qu'il prétend combattre. La solution n'est pas dans le "socle commun", mais dans la mise en place de programmes exigeants, notamment en français et en mathématiques.
NB : "observer la langue" ; l'expression est une allusion à l'ORL ("Observation raisonnée de la Langue") qui a remplacé dans les écoles primaires l'étude systématique de la grammaire, du vocabulaire et de l'orthographe ; avec la méthode globale ou prétendument "semi-globale" d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, en lieu et place de la méthode traditionnelle d'association graphème/phonème, cette méthode préconisée par une agrégée de grammaire (!) a fortement contribué au désastre actuel.
Voici une réflexion de fond sur le sujet d'Estelle Manceau, professeur de Lettres :
Quelques réflexions sur le socle commun
On peut déjà s’interroger sur la place du socle commun par rapport aux programmes : la formulation du texte* est en effet extrêmement ambiguë " Bien que désormais il en constitue le fondement, le socle ne se substitue pas aux programmes de l’école primaire et du collège ; il n’en est pas non plus le condensé. Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire fondamentale, en se plaçant du point de vue de l’élève (…) ". Qu’est-ce que cela signifie ? Cette formulation reprend un cliché : les programmes ne constitueraient qu’un empilement de connaissances dans lequel les élèves ne verraient aucun sens. Le socle serait une sorte de synthèse, unifiant les connaissances dispersées parmi les différents programmes dans un but cohérent. On peut déjà contester le fait de se placer " du point de vue de l’élève " : ce sont en réalité les concepteurs du socle qui imposent le sens qu’ils souhaitent à l’élève, alors que c’est justement en intégrant les connaissances définies dans les programmes que l’élève leur trouve un sens. En outre, nous avons ici le risque d’un tri dangereux et arbitraire, entre ce qui pourra trouver sa place dans l’objectif global défini par le socle, et ce qui en sera exclu ; ce tri risque d’être à la fois qualitatif (définition d’un socle réduit) mais aussi idéologique (le choix des compétences retenues valorise un certain type de société et d’individu).
Le socle met en avant sept compétences : cinq déjà mises en œuvre (maîtrise de la langue française, pratique d’une langue vivante étrangère, mathématiques et culture scientifique et technologique, techniques usuelles de l’information et de la communication, culture humaniste) et deux auxquelles on a porté moins d’attention jusque-là (compétences sociales et civiques, autonomie et initiative des élèves). Cette structuration en compétences a déjà pour but de casser l’organisation de l’enseignement par disciplines, ce qui ne constitue pas une tentative nouvelle : les compétences énumérées pourraient être enseignées dans toutes les disciplines et celles-ci concourent toutes à l’acquisition du socle ; la conclusion de l’annexe du décret conclut sur l’aspect global du socle (à l’inverse d’une division en disciplines). On peut deviner quelles conséquences concrètes cela pourrait avoir : plus aucune discipline ne devient vraiment indispensable, il sera donc possible de diminuer les horaires ; c’est aussi une manière de préparer le terrain pour les professeurs bivalents.
En outre, la liste de ces compétences m’inspire de réelles inquiétudes quant à leur contenu. D’abord, on remarque de grands absents, l’histoire et géographie, les langues anciennes, l’EPS, les sciences physiques, les sciences naturelles, la langue vivante 2 ; je laisse de côté la philosophie, puisque le socle concerne l’école primaire et le collège, mais que dire d’un socle censé être le " ciment de la nation ", privé d’une originalité remarquable de l’enseignement français ? Mais cela pose la question de l’âge de la scolarité obligatoire et de la poursuite d’études après le brevet. On remarque aussi qu’en structurant le système par le socle, on exclut la dissertation, exercice central dans l’enseignement français. Revenons aux disciplines du collège et examinons leur sort dans le socle
L’histoire et la géographie sont noyées dans la " culture humaniste ", de la même façon que sciences naturelles (biologie et géologie) et sciences physiques sont noyées dans la " culture scientifique et technologique " ; on voit ici un risque évident d’abandon de la rigueur propre à l’étude des différentes disciplines : analyser un document historique, ce n’est pas lire un texte littéraire. De plus, le programme des disciplines (même s’il est souvent critiquable) propose un ensemble de savoirs articulés ; le socle commun risque d’aboutir à une vision très superficielle de ces disciplines : il s’agit d’avoir un vernis, d’être capable de soutenir une conversation sur le sujet à un niveau sans doute proche de celui des médias.
L’EPS disparaît en tant que discipline, il est éparpillé parmi les différentes compétences, d’une manière qui confine parfois au ridicule : c’est ainsi que dans la compétence " autonomie " après une liste de connaissances concernant essentiellement l’économie, il est mentionné " avoir une bonne maîtrise de son corps, savoir nager " ; si j’avais mauvais esprit, je serais fortement tentée de donner un sens figuré à l’expression " savoir nager ". Cette fragmentation de la discipline aboutit aussi à sa récupération idéologique, puisque dans les capacités développées par la " culture humaniste " il est demandé de " développer par une pratique raisonnée, comme acteurs et comme spectateurs, les valeurs humanistes et universelles du sport " ; notons au passage la démagogie qui consiste à " caser " le sport dans la culture humaniste, car je ne crois pas du tout à une référence à la culture gréco-romaine (ou alors les rédacteurs n’auraient rien compris au rôle du sport dans l’Antiquité) ; on le voit aussi dans la rubrique " capacités " de la culture scientifique " comprendre le fonctionnement de son propre corps et l’incidence de l’alimentation, agir sur lui par la pratique d’activités physiques et sportives ". Le sport est donc avant tout compris comme un instrument du contrôle social de l’individu : contrôle du corps, avec toutes les dérives qu’entraîne cette conception (l’idée selon laquelle on est totalement responsable de son propre corps est très pernicieuse sur le plan personnel et elle est source d’un conformisme physique dangereux), contrôle social, le sport étant associé, de façon parfois illusoire, à la solidarité, au respect des règles. Cette vision du sport est réductrice, car il n’a pas forcément vocation à transmettre des valeurs, et celles qu’il véhicule sont parfois très contestables ; je souhaiterais que les auteurs du texte (re ?) lisent W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec.
Les disciplines que je viens d’évoquer ont au moins le privilège d’apparaître dans le socle ; mais je suis extrêmement inquiète en ce qui concerne les langues anciennes, qui en sont totalement absentes ; dans la " culture humaniste ", il est fait allusion aux textes antiques, mais jamais aux langues anciennes ; qu’est-ce qu’une " culture humaniste " privée de ce qui est au coeur de l’Humanisme, la découverte des textes dans leur langue d’origine ? Il est étonnant également que la " maîtrise de la langue française " et la " pratique d’une langue étrangère " oublient cet atout essentiel qu’est la connaissance du latin ou du grec.
La mention d’une seule langue vivante dans le socle commun donne évidemment, même si ce n’est jamais dit explicitement, une place de monopole à l’anglais.
Je suis également inquiète quand je vois les " techniques usuelles de l’information et de la communication " mises en avant : le medium est donc mis sur le même plan que le contenu : nous assistons là à une véritable dérive, puisque les élèves sont incités à imiter le modèle superficiel, fondé sur l’apparence, que leur offrent les médias ; savoir communiquer devient aussi important, peut-être plus, que savoir tout simplement. Le texte définit cette " compétence " en disant " La culture numérique implique l’usage sûr et critique des techniques de la société de l’information " ; or, ce qui permet cet " usage sûr et critique ", c’est le savoir. Le texte insiste également beaucoup sur la notion de " responsabilité " dans l’usage de ces techniques : redouterait-on un usage plus subversif, pourtant déjà avéré ? Les concepteurs du socle n’ont même pas le courage d’assumer jusqu’au bout leur confiance dans les TIC.
Définir " l’autonomie et l’initiative " des élèves comme une compétence, n’est-ce pas absurde ? L’autonomie et l’initiative s’acquièrent avec les connaissances, la pratique régulière des exercices dans les différentes disciplines, cela n’a aucun sens d’en faire une compétence. On observera que " l’autonomie et l’initiative " recouvrent l’orientation et la connaissance de l’environnement économique ; pour les rédacteurs, environnement économique = entreprise (et l’Etat, dans tout ça ?) ; le texte préconise " une ouverture d’esprit aux différents secteurs professionnels et la conscience de leur égale dignité " : il s’agit ici d’inciter les élèves à s’orienter vers l’enseignement professionnel et l’apprentissage ; je ne doute pas de " l’égale dignité " de tous les secteurs professionnels, mais dans une société où existent de tels écarts dans les salaires, les conditions de travail, la liberté d’agir et de se défendre, dans l’image et la considération, je crains que cette expression n’apparaisse comme un gros mensonge… Enfin, faire de l’orientation une compétence, n’est-ce pas oublier que le but de l’école est d’abord de donner l’instruction la plus complète possible, seule vraie garantie d’une orientation judicieuse, quel que soit le domaine professionnel choisi ?
Plus grave encore, définir des " compétences sociales et civiques " me semble un danger grave pour la démocratie ; qui décrète qu’un citoyen est compétent ou non ? Comment évaluer ces compétences ? Les enseignants eux-mêmes ont-ils ces compétences " civiques " ? Le risque de formatage idéologique est évident, surtout si l’on évalue ces " compétences " : on voit aussi la confusion que cela entraîne entre civisme et conformité à une norme sociale et morale. Dans les capacités attendues, il est recommandé de " rechercher un consensus " : gare à la différence et à l’audace ! Et gare à la démocratie, système politique qui intègre le conflit des idées et des intérêts dans son fonctionnement même. En outre, le texte propose une définition intéressante de la solidarité : " nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes en difficulté (physiquement, économiquement) en France et dans le monde " : cela ressemble plutôt à de la charité (que je ne considère pas forcément comme un mal, mais qui n’est pas l’objectif de l’école) ; mettra-t-on un bonnet d’âne à ceux qui refusent de vendre des petits pains à l’occasion du prochain raz-de-marée ? Ne devrait-on pas plutôt donner les moyens aux élèves de réfléchir à l’organisation des sociétés, à leur économie, à leurs systèmes politiques ?
Le risque de formatage est donc aussi psychologique, puisque le préambule du socle définit ce que sont les " attitudes indispensables tout au long de la vie " : " ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d’autrui, la curiosité et la créativité ". Si certaines des qualités énoncées sont incontestables, on peut souligner la démagogie et le conformisme de ce portrait d’un individu idéal ; quelle va être la place des timides, des discrets, de ceux qui ne brandissent pas une nouvelle idée, un nouveau " projet " à tout instant ? Etre compétent ne signifie pas forcément être créatif : là encore, on risque de favoriser outrageusement l’individu qui sait se mettre en avant, pas nécessairement le plus savant ou le plus… compétent. Que signifie de plus l’éloge systématique de la " créativité " dans une vision si uniforme des individus ? Nous sommes ici en contradiction avec la recherche du consensus réclamée plus haut : un individu créatif est parfois celui qui justement sait aller contre une opinion consensuelle.
Bien sûr, on se réjouit de l’accent mis sur la maîtrise de la langue française, en particulier sur l’orthographe et la grammaire. Mais la définition de cette compétence comporte des points à mes yeux inquiétants ; d’abord il est dit que " la fréquentation de la littérature d’expression française est un instrument majeur des acquisitions nécessaires à la maîtrise de la langue française " : même si la lecture des œuvres littéraires concourt à la maîtrise du français, il me semble réducteur de ne la faire apparaître que comme un outil pour apprendre la langue (on retrouve les travers de l’enseignement en séquences) ; il est regrettable que l’inverse ne soit pas dit, à savoir qu’il faut maîtriser le français pour accéder aux œuvres littéraires ; est-il si inconcevable de présenter la lecture d’une œuvre littéraire comme un but en soi ?
Autre problème, en affirmant que l’acquisition de la langue française est le rôle de toutes les disciplines, on légitime la réduction des horaires alloués à la discipline. J’ai déjà soulevé la question pour l’ensemble des disciplines, mais c’est bien en français que la réduction des horaires a eu les conséquences les plus catastrophiques.
On observe une autre perversion de la fragmentation en compétence : le développement de l’esprit critique devient l’apanage de la culture scientifique et technologique, alors que la maîtrise du français y joue un rôle essentiel. Cela prouve un peu plus l’aberration de cette structuration en " compétences ".
La définition de la compétence " pratique d’une langue vivante " comporte des éléments dangereux, en particulier la mention du " cadre européen de référence pour les langues ", conçu par le Conseil de l’Europe, avec la précision du niveau A2 comme objectif. Pourquoi ne pas élaborer des références proprement françaises et pourquoi surtout abdiquer notre capacité à évaluer les élèves selon nos propres critères ? On peut redouter des ambitions très limitées pour l’enseignement des langues, surtout si on relève les buts énoncés " des situations courantes de la vie quotidienne ", " bref propos ", " brève intervention ou échange court " ; par ailleurs dans les " attitudes " (je ne m’explique pas le choix de ce terme autrement que par l’obsession des apparences) préconisées, on recommande la lecture du journal, la consultation des médias, le visionnage des films, mais le livre n’apparaît pas.
Cette insistance sur la " vie quotidienne " revient régulièrement dans la compétence " mathématiques, culture scientifique et technologique " : on peut relever " compréhension de l’univers quotidien ", " approches concrètes et pratiques ", la résolution de problèmes " à partir de situations proches de la réalité ", plus loin " le fonctionnement d’objets de la vie courante " ; or l’approche de la science par la vie courante est une impasse, car cela fait intervenir des notions très complexes. On remarque aussi une atteinte à la liberté pédagogique, puisque il est fortement recommandé de faire appel à " l’habileté manuelle ", et que plus loin la méthode de " la Main à la pâte " est explicitement mentionnée ". Il est dangereux d’orienter ainsi les pratiques pédagogiques. On peut aussi regretter l’influence de l’actualité médiatique (puisque dans les " capacités ", les élèves doivent être capables de comprendre le discours médiatique sur les sciences), qui impose une vision à court terme : la science et les média sont deux domaines évolutifs par nature ; ce sont donc les notions qui doivent s’imposer dans un ordre cohérent, indépendamment de l’air du temps. Et là encore, on retrouve la volonté de donner un cadre idéologique à l’enseignement puisqu’il est écrit que " les élèves doivent comprendre que les sciences et les techniques contribuent au progrès et au bien-être des sociétés " ; je suis la première à reconnaître les bienfaits de la science et de la technologie, mais on n’a pas à imposer cette idée dans la tête des élèves : après tout, tout le monde a le droit de penser le contraire (ne voyez pas dans ma remarque une volonté de retour aux cavernes !).
Bien sûr, je l’ai déjà en partie évoqué, je n’ai pas du tout le même avis que les auteurs sur ce que doit être la " culture humaniste " : elle est définie ainsi " la culture humaniste participe à la construction du sentiment d’appartenance à la communauté des citoyens " ; la volonté de rassembler apparaît très nettement dans ce chapitre du texte, puisque vers la fin on lit " Elle [la culture humaniste] développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose d’universel ". Je suis étonnée (mais je m’exprime là avec toute ma subjectivité) que l’on utilise à ce point la culture humaniste comme un instrument de cohésion sociale. La culture humaniste permet aussi de prendre conscience de sa singularité : en tout cas, elle ne saurait être récupérée pour construire une illusion de communion universelle.
Estelle Manceau
* B.O. n° 29 du 20 juillet 2006 : Socle commun de connaissances et de compétences
10/2006