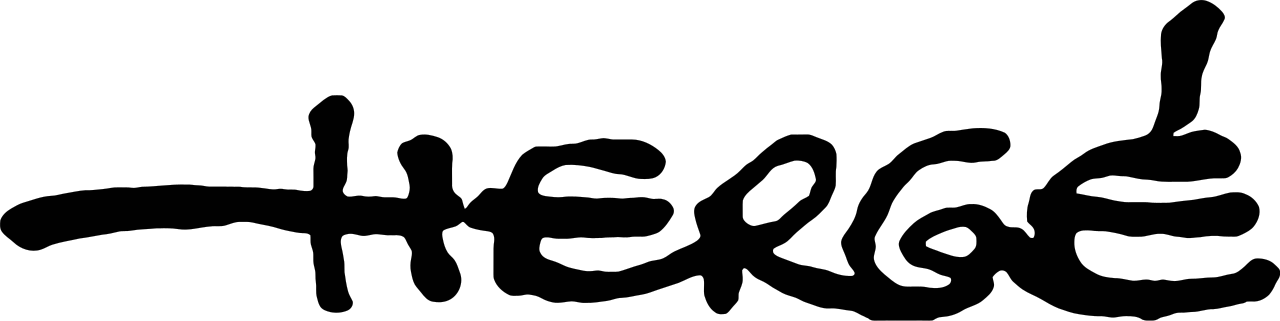Electre est le sujet de ma nouvelle série inspirée par l'opéra éponyme de Richard Strauss dans la mise en scène de Patrice Chéreau pour le festival d’Aix en Provence . Je reviendrai plus loin sur cet opéra et ce spectacle. Tout d'abord allons à la source qui a inspiré Hugo von Hofmannsthal le librettiste de l'opéra de Strauss.
Le thème de l'Électre de Sophocle qui se rapporte aux légendes troyennes, est celui-là même qui fut traité par Eschyle dans ses Choéphores à la différence notable que c' est Electre qui est au cœur de l'intrigue et non son frère Oreste.
Sophocle n'est pas le seul à avoir écrit sur le thème d'Électre. La richesse des légendes grecques a été une source inépuisable d'inspiration pour les Tragiques. Ils ont proposé chacun de leur côté leur propre version de tel ou tel mythe: par exemple, Eschyle et Euripide avaient écrit un Œdipe, perdu, comme, malheureusement, la plus grande partie de la production des poètes tragiques. S'agissant d'Électre, Eschyle et Euripide en ont fait le thème central d'une de leurs pièces, que nous possédons encore, ce qui permet de comparer, texte à l'appui, les différences de traitement, tant du point de vue de la psychologie des personnages que des modifications opérées dans le mythe.
Dans ses conférences sur l'art et la littérature dramatiques, Schlegel a fait une comparaison entre les femmes endeuillées imaginées par Eschyle et l'Électre de Sophocle. Il montre qu'Eschyle a traité l'aspect le plus sombre de l'histoire, évoquant en détails les divinités terribles de la vengeance, les Érinyes. Sophocle, tout en n'oubliant pas cet aspect, raconte l'histoire avec infiniment moins de cruauté, en focalisant l'attention sur la seule Électre, sa constance dans l'adhésion à ses convictions profondes, et son héroïsme dans la souffrance.
« Ce qui caractérise particulièrement la tragédie de Sophocle est le peu d'influence qu'ont les dieux dans cet environnement pour le moins effrayant. En fait, la fleur de la vie et la jeunesse imprègne tout le décor. Apollon, le dieu-soleil, semble jeter son éclat partout ; même le point du jour avec lequel la pièce débute est tout à fait significatif. Le monde des tombes et des ombres est gardé à distance ; ce qui dans Eschyle est inspiré par l'âme de l'homme assassiné vient ici du cœur d'Électre vivant, qui se livre à l'amour autant qu'à la haine avec une force égale. »
Sophocle donne à Oreste une individualité plus cohérente qu'Eschyle. Avant, ou après le meurtre, Oreste ne montre jamais la moindre hésitation. Aucun scrupule de conscience ne le ronge. Il est beaucoup plus inflexible que l'Oreste peint par Eschyle comme le prouve la mise en scène macabre auquel il se livre avec le cadavre de sa mère avant de tuer Égisthe. Mais c'est dans le rêve de Clytemnestre qu'apparait le mieux le traitement différent des deux tragédiens. Celui d'Eschyle, terrifiant, intimidant au possible, est au cœur même de l'intrigue, alors que le rêve évoqué par Sophocle est, certes, majestueux dans son horreur, mais apparaît comme un détail secondaire et peu déterminant. Le surnaturel y est moins intense. Au drame symbolique teinté de mysticisme propre à Eschyle succède donc le drame psychologique sophocléen.
Quant à l'Électre d'Euripide, nous savons, vraisemblablement, qu'elle était contemporaine de celle de Sophocle, sans doute très légèrement postérieure. On l'a datée avec certitude de 413 av. J.-C. ; la pièce de Sophocle daterait, elle, d'environ 415.
Les différences entre les deux Électre sont criantes, même si Sophocle reprend à son compte les nouvelles tendances théâtrales de son époque, marquée par les innovations d'Euripide. Par rapport à Antigone, on constate une plus grande importance de l'action et une peinture plus expressionniste des personnages centraux. Cependant, dans Électre, si Sophocle offre grandeur et noblesse à son héroïne, Euripide, lui, fait le portrait d'une femme, certes résolue, mais plus trouble, plus cruelle, et moins digne. Le traitement euripidien tend à exacerber le côté passionnel de l'Atride, ce qui est bien dans sa manière. Quant à Oreste, il apparaît plus indolent, plus hésitant que le personnage créé par Sophocle. Inversement, la Clytemnestre d'Euripide est plus humaine, plus touchante, plus ambiguë que celle de Sophocle, qui apparaît sous le jour d'une femme très minérale, que nul sentiment ne trouble, et qui va même jusqu'à se réjouir de la mort de son propre fils. Chrysothémis est une pure invention de Sophocle : à travers elle, le poète renouvelle la confrontation entre deux sœurs comme dans Antigone, où Ismène, bien qu'alliée à sa sœur, montrait une personnalité plus souple qu'Antigone. Dans Électre, Sophocle radicalise les positions, au point que Chrysothémis devient la symbole de la mollesse, de la complaisance, voire de la compromission au pouvoir, choses qu'Électre ne peut supporter.
Adepte du « tout ou rien », inconsolable absolue, Électre vue par Sophocle est l'une des personnalités les plus fortes de tout le répertoire tragique grec. On peut la comparer avec l'Antigone du même auteur dans la fermeté des convictions et le courage sans limite. Mais Antigone agit dans le sens de l'amour. Électre tourne ses regards vers le « côté obscur », avec une seule finalité, une obsession même, qui tient de la pathologie : venger son père et se débarrasser de meurtriers impies doublés de tyrans odieux. Une autre différence notable avec Antigone, sa rage continuelle, ses éruptions verbales, voire sa morbidité, qui n'ont rien à voir avec le calme, la « force tranquille » de l'héroïne thébaine qui marche au supplice avec une fière résignation.
Toutefois, Électre a en commun avec Antigone la certitude d'être dans son bon droit, et elle n'éprouve visiblement aucun remords à réaliser avec Oreste son plan terrible, contrairement à l'Électre d'Euripide, un moment désarçonnée par l'horreur de son acte. Le meurtre d'Égisthe et de Clytemnestre ne semble pas avoir beaucoup choqué Sophocle, au point que sa tragédie exclut toute idée d'une vengeance divine, normalement consécutive à tout matricide. En effet, chez Eschyle et Euripide, les Érinyes, déesses de la vengeance, interviennent aussitôt l'assassinat perpétré. Dans les Euménides d'Eschyle, dernier volet de l'Orestie, Oreste devra procéder, non sans difficulté, à sa purification. De tout cela, nulle trace chez Sophocle, qui termine la pièce sur la fin de la malédiction des Atrides que ce meurtre, que l'on peut qualifier de légitime, a permise. La question d'une quelconque suite à donner à un acte si terrible, aussi lourd de conséquences dans la mentalité grecque, ne se pose même pas. Beaucoup d'auteurs antiques et même contemporains se sont d'ailleurs sentis troublés par une fin aussi brutale. D'aucuns y ont vu une justification tous azimuts de l'assassinat politique dans des circonstances particulières, comme Antoine Vitez dans sa mise en scène d'Électre en 1971 et 1986, qui a comparé, pour la justifier, la liquidation des deux Atrides avec les assassinats des plus ignobles collaborateurs à la Libération. Ainsi, dans le personnage d'Égisthe revu par Vitez, on reconnaît ouvertement Pierre Laval !
La pièce est remarquablement bien construite, avec une progression d'une grande intensité. La subtilité du ressort dramatique y est même supérieure à celle de l'Œdipe. De par ces qualités, Électre fut la tragédie la plus admirée par les érudits dès l'époque hellénistique.
Plus près de nous, l'œuvre a inspiré à Voltaire une pièce assez faible, puis au XXe siècle, Giraudoux et Hofmannsthal, dont le drame fournit la matière du livret de l'opéra le plus ambitieux et le plus noir de Richard Strauss, en 1909.
Avant de devenir un opéra emblématique de la modernité, Elektra est une pièce de théâtre de Hugo von Hofmannsthal. Comme Arthur Rimbaud, Hofmannsthal est un poète prodige qui a renoncé très tôt à la poésie, mais en continuant une carrière littéraire qu’il partagea essentiellement entre le théâtre et ses activités de librettiste. C’est au Deutsches Theater de Berlin, en octobre 1903, que Richard Strauss découvre la tragédie de Hofmannsthal, Elektra. Le point de départ d’Elektra sera donc identique à celui de Salomé (1905) adaptée de la pièce d’Oscar Wilde que Hofmannsthal avait vue à Berlin dans une production du même Reinhardt avec la même Gertrud Eysoldt… Mais si le musicien est d’emblée attiré par la pièce de Hofmannsthal qui fait écho à ses propres préoccupations artistiques, il hésite encore devant un sujet trop proche de celui de Salomé au moment où il souhaite explorer d’autres domaines. Le 11 mars 1906, le compositeur écrit au dramaturge :
« Je suis plus passionné que jamais par ‘Elektra’ et j’ai déjà fait quelques coupures pour mon propre usage. La seule question que je n’ai pas encore décidée (…) est de savoir si, immédiatement après ‘Salomé’, j’aurai la force de traiter un sujet aussi semblable par maints aspects avec une entière fraîcheur d’esprit, ou si je ne devrais pas attendre quelques années avant d’approcher ‘Elektra’, jusqu’à ce que j’aie évolué suffisamment loin du style de ‘Salomé’ ».
Le 27 avril, Hofmannsthal, très désireux de travailler avec le musicien, lui répond de manière à dissiper définitivement ses doutes :
« Les « ressemblances » avec l’histoire de ‘Salomé’ me paraissent, si l’on y regarde bien, se résumer à rien (…). Le mélange des couleurs dans les deux sujets me paraît tout aussi différent dans leurs composants : dans ‘Salomé’, mieux vaut parler de mauve et de violet, l’atmosphère est torride ; dans ‘Elektra’, c’est au contraire le mélange de lumière et de nuit, d’obscurité et d’éclat (…) Mieux, la séquence, qui va rapidement crescendo, des événements relatifs à Oreste et à son acte (…) je peux (l’) imaginer bien plus forte quand elle est mise en musique qu’avec des mots écrits »
Sommet absolu de la tragédie lyrique, inspirée de la tragédie de Sophocle, Electre, associe une musique d’une grande audace et le crescendo d’une intrigue, d’une violence dramatique jusque-là inégalée. On reprocha souvent à Strauss ses excès d’orchestration. Ainsi, le rôle d’Electre, par la présence des tourments hystériques qu’il commande, est l’un des plus éprouvants et exigeants du répertoire lyrique. Malgré un accueil réservé, insensiblement, l’opéra, dont le monologue final et la danse infernale d’Electre restent l’épicentre mélodramatique de l’ouvrage, fit la conquête des plus grandes scènes lyriques à travers le monde.
Avant d aller plus loin voici un résumé de l'ouvrage.
Electre, inconsolable, tout entière absorbée par le désir de venger la mort d'Agamemnon son père assassiné par sa mère Clytemnestre et son beau-père Egisthe pleure. Chassée du palais par Clytemnestre en proie à de terribles cauchemars prémonitoires, l’intransigeante Electre tente en vain d’obtenir l’aide de sa sœur Chrysothémis qui lui refuse. Cette dernière la met en garde contre Clytemnestre et Egisthe qui veulent l’enfermer. Electre espère aussi le retour de son frère Oreste , exilé loin du palais quand il était enfant. Seul son retour pourrait permettre d’accomplir enfin le châtiment des deux meurtriers du valeureux Agamemnon. Un mystérieux étranger arrive, qui n’est autre qu’Oreste dont on avait annoncé la mort. Il est venu pour seconder sa sœur dans son implacable soif de vengeance.
La rencontre d’Electre et de sa mère révèle toute la haine et le ressentiment que se vouent les deux femmes, et combien Electre veut la voir mourir sous les coups de son frère. Après le départ de Clytemnestre, Chrysothémis vient annoncer à sa soeur la mort d’Oreste. Electre plonge alors dans un profond désarroi. Or l’un des deux étrangers porteurs de l’affreuse nouvelle n’est autre qu’Oreste lui-même, qui s’est fait passer pour mort afin de s’introduire au palais pour venger son père. La scène des retrouvailles, laisse paraître toute la tendresse et l’amour d’une sœur envers son frère. Oreste part accomplir Le châtiment. Le cri de Clytemnestre, suivi par le hurlement d’Egiste, confirment le double meurtre. Electre, toute à sa joie, s’adonne à une danse frénétique avant de s’effondrer sans vie, laissant sa sœur désespérée et son frère silencieux.
Allons plus loin.
Opéra hors norme dont on a souligné à l’envie la démesure et l’éblouissante fulgurance, Elektra se déroule en un seul acte d’une tension extrême, centré autour d’une héroïne dévorée par une soif de vengeance obsessionnelle. L' orchestre porte jusqu’aux limites du langage tonal un drame qui puise sa part de ténèbres et de démence dans une antiquité primitive marquée par une sauvagerie troublante. Cette adaptation du mythe d’Electre, contemporaine des recherches freudiennes sur l’hystérie, offre une conception nouvelle des personnages requerant un langage musical dont la règle principale semble l’excès.
Romain Rolland écrit dans une lettre à Strauss datant de 1909 l’année de la création d’Elektra: « On est enveloppé et balayé d’un bout à l’autre par une force tragique. Plus qu’aucune autre de vos œuvres, celle-ci s’imposera à tous les théâtres du monde». C’est cette «force tragique» à la violence inédite qui induit une conception moderniste sollicitant toutes les ressources vocales de chanteurs menés aux limites de l’expression musicale.
La création d’Elektra eut lieu à l’Opéra Royal de Dresde le 25 janvier 1909. On peut parler d’un « succès d’estime » comme le note Strauss lui-même. Bien qu’il ait été repris sur de grandes scènes internationales dans les mois suivants, l’ouvrage était bien trop en avance sur son temps pour rencontrer un véritable triomphe.
Pour rendre l’atmosphère chargée d’agressivité et de démence qui caractérise cet opéra de la vengeance, Strauss fait se déchaîner un orchestre qui dresse une véritable barrière sonore, réclamant des chanteurs aux capacités exceptionnelles.
Dès les premières mesures de l’opéra, l’extrême violence de l’écriture rappelle certaines pages de Wagner. Une sorte de chaos orchestral traduit le chaos intérieur des protagonistes. Mais Strauss va encore plus loin. Il n'hésite pas à utiliser des procédés nouveaux, il s’engage résolument dans la recherche d’un « primitivisme musical » chargé de donner vie à un monde légendaire archaïque, au sens propre du terme, c’est-à-dire originel. Nous entrons avec Elektra dans l’univers de La Naissance de la Tragédie (1872) que Nietzche dédia à Richard Wagner. Nous retrouvons l’ivresse de Dionysos, l’impact foudroyant d’un mythe des origines, très loin de la sérénité apollinienne de la Grèce, modèle du classicisme. Elektra semble annoncer les déchaînements et les pulsations d’un rituel sauvage et primitif dont les rythmes inouïs et obsédants se feront entendre dans Le Sacre du Printemps (1913) de Stravinsky.
« Une force tragique »
Elektra s’ouvre abruptement. En guise d’ouverture s’impose un thème évoquant d’emblée Agamemnon, le héros qui à son retour de la guerre de Troie a été traîtreusement assassiné par son épouse et l’amant de celle-ci, Egisthe. L’auditeur est brutalement arraché au réel pour être emporté par «une force tragique» exceptionnelle pour un peu plus d’une heure et demie, jusqu’à ce que le vertige de la vengeance enfin accomplie submerge l’héroïne qui meurt dans les transes d’une danse sauvage et extatique. Elektra plonge ses racines dans la sanglante histoire d’une famille maudite, celle des Atrides qui régna sur une Mycènes légendaire, fascinante et inquiétante, symbole de la barbarie des temps immémoriaux. Richard Strauss, est attiré par cette Grèce des premiers âges mise en pleine lumière par le célèbre archéologue Heinrich Schliemann. Dans une Mycènes, « mélange de lumière et de nuit », Strauss et Hofmannsthal installent leur ouvrage commun. Les indications scéniques laissées par Hofmannsthal pour la représentation de sa pièce de théâtre étaient déjà sans ambiguïté. Elles éclairent aussi les enjeux de l’opéra où elles trouvent un prolongement aussi bien dans la construction du livret que dans les affrontements entre personnages :
« Le décor ne comporte absolument aucune de ces colonnes, de ces larges marches d’escalier, de toutes ces banalités antiquisantes qui sont plus propres à refroidir le spectateur qu’à agir sur lui de manière suggestive. Les caractéristiques du décor sont l’exiguïté, l’absence de possibilité de s’enfuir, l’impression d’enfermement(…) La grande cime d’un figuier (…) permettant de recouvrir la scène de bandes d’un noir profond et de taches rouges (…) Et l’on voit briller sur le mur ainsi que sur le sol de larges taches de sang ».
Comme je l'écrivais plus haut, on retrouve les principaux éléments de la légende des Atrides dans les poèmes homériques, puis chez les trois grands auteurs tragiques que sont Eschyle, Sophocle et Euripide. Hofmannsthal a privilégié la perspective retenue par Sophocle qui construit son drame autour d’une Electre animée par un inflexible désir de vengeance contrastant avec le droit à l’oubli que revendique sa sœur Chrysothémis. Comme l’Electre de Sophocle, celle de Hofmannsthal vit uniquement dans l’attente du retour de son frère Oreste, le seul qui puisse accomplir son implacable volonté : venger le meurtre de son père Agamemnon en tuant ses meurtriers. Richard Strauss avait quant à lui une idée très précise du personnage d’Oreste auquel Hofmannsthal dut apporter quelques modifications à la demande expresse du musicien. Pour donner plus d’intensité au moment crucial où la sœur reconnaît son frère dont on vient faussement d’annoncer la mort, Strauss demande à son librettiste d’ajouter «quelques beaux vers». Cette scène de la reconnaissance entre les deux enfants de Clytemnestre et d’Agamemnon constitue un des sommets de l’ouvrage. Elle «touche au sublime du cœur» ainsi que l’écrivait Romain Rolland. Mais si Oreste apparaît comme la main du destin, sa présence n’égale pas celle des trois femmes dont la confrontation détermine le déroulement implacable du drame. Electre, Clytemnestre, sa mère meurtrière, et Chrysothémis, sa sœur trop humaine, dominent véritablement l’opéra.
Une histoire de femmes
L’opéra de Strauss comporte trois grands rôles féminins . Trois femmes unies par les liens du sang s’affrontent dans un grand déchaînement de violence sans pouvoir se comprendre. La mère et les deux filles sont à jamais séparées par le sang de l’époux assassiné, qui reste pour Electre un père dont l’absence est irremplaçable, tandis qu’il n’est pour Chrysotémis qu’un cruel souvenir à oublier pour tenter de vivre.
Rendue inflexible jusqu’à la sauvagerie par son obsessionnelle soif de vengeance, le personnage d’Electre semble d’ailleurs s’apparenter à l’un des cas cliniques décrits par Sigmund Freud et son collègue Josef Breuer dans les Etudes sur l’Hystérie qu’ils publièrent à Vienne en 1895. C’est en tout cas un des rôles les plus écrasants de tout le répertoire lyrique. Electre fait sa première apparition sur scène d’une façon tout à fait saisissante dans un premier monologue. Elle sort de sa tanière comme chaque jour à son heure, « l’heure où elle pleure son père si fort que de ses hurlements tous les murs retentissent ». Sur un rythme de marche funèbre, la fille évoque le supplice du père dont elle invoque plusieurs fois le nom dans un appel déchirant qui scande son chant. A la fin de son monologue comme au début, retentira encore comme un cri le nom d’Agamemnon. Electre est aussi cette fille aimante qui implore son père avec la faiblesse de la tendresse : « Agamemnon ! Père! Je veux te voir, ne me laisse pas seule aujourd’hui ! Telle une ombre, montre-toi à ta fille là-bas, dans le recoin du mur, comme hier ! ». A cette douceur succède bientôt la violence des imprécations et la joie sauvage à l’idée de la vengeance qui va s’accomplir : « Ton fils Oreste et tes deux filles, nous trois quand tout sera accompli (…) Nous, qui sommes ton sang, nous danserons autour de ta tombe ». A la fin de l’opéra Electre sera emportée dans une transe sauvage, avant de s’écrouler, morte.
A côté d’Electre se tient sa sœur Chrysothémis. Elle ne partage pas la haine de sa sœur, mais craint les conséquences que son intransigeance pourrait avoir. Chrysothémis exprime des sentiments très différents : humaine, attirée par un bonheur maternel simple, elle représente la lumière et la volonté d’apaisement face à l’hystérie d’Electre. Le troisième personnage féminin de l’ouvrage est Clytemnestre, l’effrayante meurtrière hantée par le sentiment de sa culpabilité. Sa première et unique apparition constitue la scène la plus éprouvante de l’ouvrage. Le « visage blême et bouffi », Clytemnestre « littéralement couverte de pierres précieuses et de talismans », les « bras chargés d’anneaux, ses doigts couverts de bagues », s’avance à la tête d’un cortège sacrificiel cauchemardesque. La reine en proie aux rêves les plus terrifiants se lance dans un monologue halluciné et glaçant. Véritable décryptage psychanalytique du personnage, ce récit où se mêlent souffrances et obsessions est porté par un orchestre qui épouse tous les méandres d’une âme tourmentée. Tour à tour hautaine, inutilement maternelle ou effrayée, puis déchirée entre la terreur et la colère, Clytemnestre quitte la scène « gavée jusqu’au cou d’une joie sauvage » en se réjouissant trop vite de l’annonce de la mort d’Oreste.
Contemporaine des premières œuvres atonales d’Arnold Schöenberg , Elektra est une des partitions les plus représentatives du début du XXème siècle. On peut rapprocher le langage musical volontairement excessif de Strauss de la sauvagerie du Sacre du Printemps de Stravinsky ou de la musique convulsive d’Erwartung composé par Schöenberg . On peut voir dans l’extraordinaire tension de ces différentes œuvres la marque d’une époque qui allait sombrer dans la sauvagerie et le chaos de la guerre. Quoiqu’il en soit, la perception d’Elektra ne doit pas être faussée par la violence du sujet et du langage musical qu’il appelle. L’écriture vocale parfois proche du cri, l’abus des dissonances et l’audace des harmonies ont pu conduire Gustav Mahler à dire qu’«il ne pouvait plus suivre» Strauss dans une telle évolution. Mais le compositeur ne semble pas chercher systématiquement à «déconstruire» pour construire un langage musical moderne. Il cherche à repousser les limites de la musique pour trouver l’expression la plus adaptée aux émotions extrêmes dont son époque a voulu s’emparer.
En juillet 2013, trois mois avant sa mort, Patrice Chéreau faisait son grand retour au Festival d'Aix-en-Provence dans la mise en scène d'Elektra". C'était six ans après «de la maison des morts» de Janacek
Cette fois, il s'agit de la maison d'un mort. Celle d'Agamemnon
Dès le prologue, silencieux, on sent que Chéreau tient sa tragédie. Les balais des servantes sur les escaliers de pierre, l'eau dispersée sur le sol afin d’empêcher la poussière de voler, sont autant de rituels antiques. La musique entre en coup de vent avec l'ouverture d'une porte. Electre, en haillons, est reléguée dans la cour avec les domestiques, en proie à des visions de mort. Patrice Chéreau lui a donné un côté clocharde céleste. La soprano allemande Evelyn Herlitzius est d'une lumière et d'une grâce confondante. Cette bête fauve et rampante, raillée par les uns, crainte par les autres, ne se dresse plus que dans la douleur de l'imprécation, dans une quête désespérée de l'autre. Luttes et enlacements procèdent de ce combat : qu'Electre embrasse les genoux de sa mère qu'elle veut pourtant détruire qu'elle lutte avec sa sœur Chrysothémis pour la convaincre de tuer avec elle, ou qu'elle enlace amoureusement Oreste reconnu sous les traits du jeune étranger venu annoncer , par ruse, sa propre mort.
Le décor est d'une pureté classique. Une cour bordée de hauts murs lissés avec au fond ce qui ressemble à un grand mihrab, des portes basses, un portail en fer plein . Dans cet espace unique, chaque détail de la mise en scène prend un relief chorégraphique : chœur des servantes, travaillé de manière picturale sur la musique, lumières raffinées , la ronde des regards jamais arrêtée. Patrice Chéreau a donné à la danse, la marque d'Electre, des gestes sinueux, rageurs ou dégingandés jusqu'à la transe. Une fois le destin accompli, Electre restera coite, comme arrêtée.
Corps et voix hallucinés, l'impressionnante Evelyn Herlitzius tient le plateau sous sa coupe de sa voix singulière aux aigus vibrionnant, aux teintes fuligineuses. Loin du monstre d'impudeur si souvent campé, la Clytemnestre de Waltraud Meier est d'une beauté touchante et profondément humaine. Le récit de ses mauvais rêves a gardé quelque chose du songe. La voix est toujours d'un chaud galbe altier. Adrianne Pieczonka, est une Chrysothémis de rêve au timbre charnu, à l'émission pleine, la ligne belle et soutenue. Celle qui veut vivre, se marier, avoir des enfants a quitté l'habituelle petite-bourgeoise conformiste pour une femme de chair, de sang et de tempérament.
Chéreau apporte le mouvement, la vérité des êtres sur le plateau. Il focalise son énergie sur la direction d'acteurs, transfigurant systématiquement la plupart des chanteurs qui auront croisé sa route.
Elektra, chant du cygne qui nous occupe aujourd'hui est la preuve ultime de la démarche de celui qui fut écartelé entre le Théâtre, d'où il venait, et le Cinéma, où il voulait aller. L'Opéra n'aurait-il été pour lui qu'un entre-deux ? C'est à voir…
Artiste aux expressions multiples, humble artisan pétri par le doute, Patrice Chéreau cherche inlassablement ce qu'un personnage de 3.000 ans d'âge peut nous transmettre. Il ne se contente pas de l'autosatisfaction commode dont il se méfie. Il nous laisse aux prises avec l'imaginaire qu'il nous lègue. Ses films, étaient toujours passionnants, rarement aboutis, et l'ultime, Persécution, carrément gênant. D'où l'idée, au bout du compte et à son cœur défendant, que l'Opéra lui aura permis les plus grands accomplissements.
Comme on est loin, avec cette Electre du monstre assoiffé de sang que l'on nous avait vendu et que l'on aurait jamais souhaité croiser au coin d'un bois ! Alors qu'ici, on découvre que l'on a tant à échanger avec elle.

 https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/Osez-Joséphine-300x200.jpg 300w,
https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/Osez-Joséphine-300x200.jpg 300w,  https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/37133800311_9c16b98651_o-300x240.jpg 300w,
https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/37133800311_9c16b98651_o-300x240.jpg 300w,  https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/15616089023_36dd65ef60_o-300x200.jpg 300w,
https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/15616089023_36dd65ef60_o-300x200.jpg 300w,  https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/Je-tuerai-la-pianiste-300x161.jpg 300w,
https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/Je-tuerai-la-pianiste-300x161.jpg 300w,  https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/24647469316_5cc5b833fb_o-225x300.jpg 225w,
https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/24647469316_5cc5b833fb_o-225x300.jpg 225w,  https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/16051172215_386af3fb27_o-300x173.jpg 300w,
https://pixbyroland.com/wp-content/uploads/2017/09/16051172215_386af3fb27_o-300x173.jpg 300w,